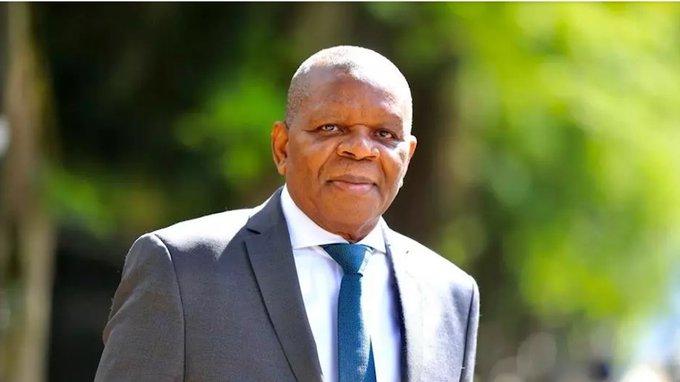Dans le procès sur l’assassinat de Thomas Sankara, les avocats de la défense prennent prétexte de la prestation de serment du président-putschiste Paul-Henri Damiba devant le Conseil constitutionnel, pour contester l’accusation d’atteinte à la sûreté de l’État. Comment comprendre qu’un tel coup de théâtre mette les magistrats autant dans l’embarras ?
Il fallait s’y attendre. Dans l’euphorie générale, ce procès a été engagé un peu trop au mépris du contexte juridique et historique des faits. La règle, à l’époque, était les coups d’État. Les pays où l’on accédait au pouvoir par des élections démocratiques étaient de très rares exceptions. Sankara lui-même était parvenu au pouvoir à la faveur d’un coup d’État, perpétré contre un putschiste, qui avait lui-même déposé un autre putschiste, ainsi de suite.
À la lumière de cette tradition bien établie de prise du pouvoir par la force, accuser Blaise Compaoré d’atteinte à la sûreté de l’État pour avoir renversé Sankara est juste une erreur. En droit, comme du point de vue historique.
L’accusation aurait sans doute été mieux inspirée de poursuivre les prévenus uniquement pour assassinat, et encore ! Car, certains de ces coups d’État se soldaient par la mort, sinon du président, du moins de ses proches, comme autant de dégâts collatéraux.
Il n’y aurait donc plus, dans ces conditions, matière à procès !
Tout au long des vingt-sept années de pouvoir de Blaise Compaoré, l’assassinat de Thomas Sankara était passée par pertes et profits. Pour que le nom de Sankara cesse d’être tabou dans les médias d’État, et que les Burkinabè commencent à le célébrer ouvertement comme l’icône de la jeunesse africaine qu’il était depuis sa mort, il aura fallu attendre la chute de Blaise Compaoré. Et dans l’euphorie générale du désir national de justice pour le défunt leader charismatique, l’accusation a pu perdre de vue le fait que Sankara n’était pas un chef d’État élu. C’est en cela que l’atteinte à la sûreté de l’État, glissée dans les chefs d’accusation, fragilise le dossier.