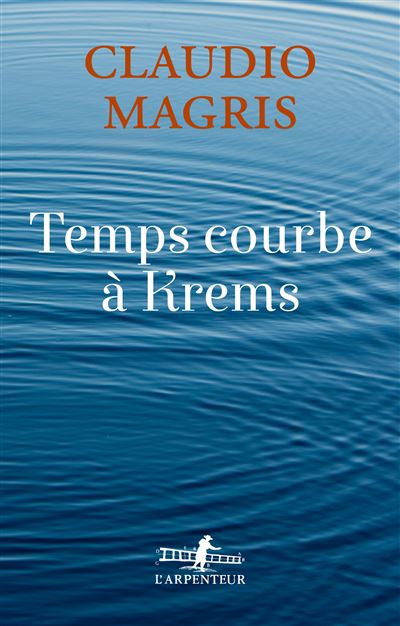J’ai lu cet été quelques grands textes dont le dernier livre de Claudio Magris. J’ai pour cet immense écrivain, chantre de la frontière, une affection toute particulière depuis la lecture du majestueux Danube, qui trace un itinéraire rempli de personnages, d’histoires et de mythes dont le fleuve reste toujours le personnage central.
Temps courbe à Krems est un recueil de nouvelles du génie triestin. A travers cinq histoires de personnages au crépuscule de leur vie, il se saisit de la vieillesse pour en extirper l’agréable, un âge d’or où l’homme est préservé des tracas dérisoires et des tumultes de la vie de ceux qui aspirent encore à réaliser de grandes choses. Il peint les parcours d’hommes comme on en croise dans ses fresques qui ont comme théâtre la mythique Mitteleuropa. A travers les figures d’un ancien homme d’affaires reconverti concierge d’un immeuble qui lui appartient ou encore d’un écrivain à la gloire fanée, il nous parle aussi du temps, de sa courbe illusoire «entre la source et l’embouchure». Il évoque la vieillesse comme l’âge d’une autre liberté, plus douce et moins extravagante, moins velléitaire et celui des souvenirs et de l’observation du temps qui fait mine de passer.
Dans ce livre, Magris nous parle à nouveau de Trieste, sa ville, cette cité dans laquelle «les temps ne se succèdent pas, mais s’alignent l’un à côté de l’autre, comme les débris des naufrages que la mer abandonne sur la plage». Trieste…
«De toute façon, là les années ne comptent pas – mais quand d’ailleurs comptent-elles ?», dit un personnage de Temps courbe à Krems, un conférencier spécialiste de Kafka, qui pourrait avoir une vague ressemblance avec l’auteur italien lui-même spécialiste entre autres du tchèque, de Joseph Roth et de Thomas Mann.
Si les années ne comptent pas ou si peu, pourquoi sacraliser la vie dans une certaine progression linéaire ? Pourquoi avancer selon des codes et des normes qui de toute façon à l’instar des années ne comptent pas ?
J’ai partagé ma lecture du livre de Magris à mon ami Mikaël Serre, metteur en scène et dramaturge franco-allemand, avec qui j’ai écrit cet été, une pièce de théâtre représentée au Monfort Théâtre.
Nous avons parlé du théâtre comme représentation de la vie, de ses soubresauts et de la particularité pour cet art de laisser des traces souvent non écrites mais dans le cœur des hommes.
Mikaël m’a invité à une réflexion sur ce temps théâtral avant la disparition mais aussi sur le sens des ultimes instants d’une vie, d’une œuvre et ce qui est digne d’y figurer.
Quelle est la fin ? Le fameux après dont le personnage facétieux derrière lequel se cache Claudio Magris nous dit ceci : «Si après, – après quoi ? –, il y avait de bonnes auberges plutôt que des anges soufflant dans leur trompette parmi les nuages, ce ne serait pas mal.»
Tous les personnages principaux de ce récit de Magris sont des hommes, pas assez fous et soucieux de la marque glorieuse du temps sur leur nom. Ils sont d’une certaine mesure, ennuyeux aussi à leur manière. Ces longs ennuis que le théoricien du temps long, des grandes obsessions et des obsessions immenses devrait chérir.
Ces personnages ne sont pas des héros libres, flamboyants et sans attaches voguant de mer en mer à la quête de l’écorchure fatale. Ils ne sont pas comme cet écrivain, précieux personnage du Frioul, qui fait le choix de l’effacement afin de ne rendre compte à personne, ni à Dieu ni aux hommes.
Mikaël me conte à son tour une histoire qu’on lui a racontée il y a quelques années dont il ne sait toujours pas si elle est vraie ou pas. Il s’agit d’une ancienne amie nationaliste corse ou sarde -il ne sait plus- qui n’avait ni la télé, ni le wifi, ni un ordinateur. Un authentique personnage de roman qui rêvait d’expérimenter la disparition voire à tout le moins une vie à la marge, afin d’inventer une terre de possibilités. Ce qui l’animait, outre la littérature et la révolution, c’était la Nation, une certaine idée de la République aussi : une République gouvernée par des hommes et des femmes sensibles à la vie des gens, à ce qui les anime, à leur accès aux services sociaux de base, à l’éducation, à la lecture et aux soins. Une République où les dirigeants penseraient de l’aurore au soir aux moyens de créer du lien pour faire nation et épargner les gens, les petites gens du danger populiste et de son insupportable démagogie.
C’est de ces rêveries aux ultimes pages de Temps courbe à Krems que je relisais pour la énième fois que m’extirpe l’agent welcome (il m’a dit que c’était son titre dans l’organigramme de l’aéroport) pour me demander le pays de mon passeport. J’avais une curieuse et ridicule fierté de répondre «Sénégal». Je l’ai dit très haut pour que tout le monde dans la file l’entende. Je l’aurais crié encore plus fort n’eut été l’attitude de décence exigée en public, en territoire étranger de surcroît. J’aurais voulu parler aux voyageurs, qui traversent eux aussi les frontières chères à Magris, de Léopold Senghor, de Douta Seck, de Jacqueline Lemoine, de Ndaté Yalla Mbodj et de toutes les grandes figures qui ont habillé cette Nation de leur nom pour que le fil de l’histoire, de cette certaine idée du Sénégal, ne se coupe jamais.