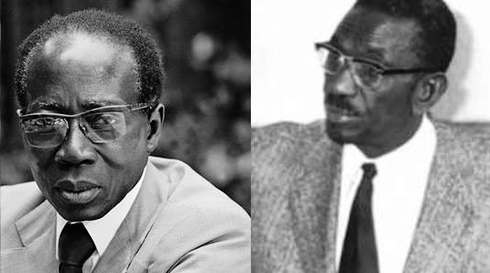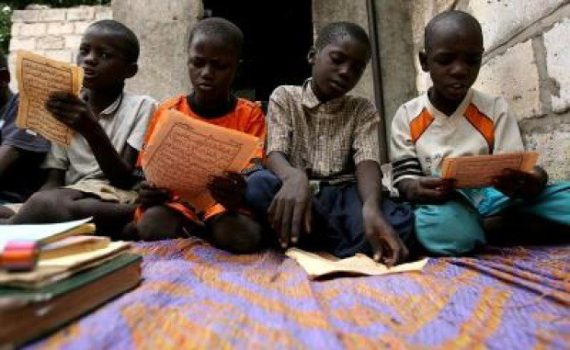Au regard du droit international de la paix (paix négative) et de la guerre (guerre juste) et des façons diverses dont il a été mis en œuvre depuis le XXème siècle, on peut en déduire deux conceptions majeures de l’ingérence comme mode d’action humanitaire pour le système des Etats comme pour celui des organisations non-gouvernementales.
Contributions de Aboubakr TANDIA
La situation du colonisé est donc chez Amadou Bamba un inconfort spirituel et religieux qui résulte de la précellence des préoccupations matérielles et de l’orientation matérialiste qui est imprimée à l’ingénierie politique de l’Etat (post)colonial. On ne saurait donc (re)penser la décolonisation sans suivre les indications légitimes de la théologie politique de l’extraversion telle qu’on en voit les préfigurations dans la critique sociale de Cheikh Amadou Bamba. Et aussi bien le colonisateur inspirateur par sa domination que le colonisé rusant et appropriant, refusant rarement, avec l’inspiration sont interpellés dans la critique théologique de l’extraversion.
Pour le politiste américain Robert Dahl la question de savoir « qui gouverne » vise à déterminer le type de régime politique en localisant l’influence. Pour l’historien français Michel Foucault, la question est bien plus que cela. Il s’agit de savoir qui « conduit » la conduite des autres, ce en agissant pour les faire agir avec succès. C’est ce que nous voulons dire ici à propos du Sénégal en considérant le caractère fondamentalement historique de la question.
L’histoire du Sénégal a été, et continue de l’être, fortement marquée par le clivage entre Senghor et Cheikh Anta Diop. Deux contemporains et ouvriers du Sénégal indépendant, chacun dans un registre prédéterminé par la division du travail d’influence idéologique sur la marche de la société, dont la mise en opposition pourrait relèver davantage de la construction sociale, de l’interprétation historiographique et de la rationnalisation politique que de la réalité historique. En attendant de pouvoir étayer cette thèse ailleurs, il suffit maintenant de souligner un paradoxe qui prospère de nos jours: le Sénégal d’aujourd’hui, celui des trois dernières décennies, est caractérisé par une sorte d’absence, d’exil imposé, de ces deux bâtisseurs. Dé-diopisation senghorienne et dé-senghorisation dioufienne obligent ? Dans tous les cas la tentative de réactualisation de la vocation panafricaniste et nationaliste par le wadisme post-alternance semble avoir manqué de réussite.
Tous les systèmes démocratiques se caractérisent en dernière instance par leur tendance quasiment naturelle à évoluer et à se transformer de manière régulière et innovante. Pour cela, les règles régissant les divers jeux de pouvoirs n’émergent pas violemment des querelles interminables et intéressées des courtisans du peuple pour sa tête et ses biens. Pas plus que de leurs compromis expéditifs et ententes indépassables. Mieux, les règles sont convenues pour être mises en œuvre de manière indistincte et durable et pour être vénérées par eux tous. Á coté et en amont des règles qui sont censées parvenir dans le répertoire des us et coutumes de la classe dirigeante, les principes qui les énoncent ou leurs servent d’adjuvants doivent valoir jusqu’à l’auto-sanction de la responsabilité individuelle. La démission par exemple, qui vaut trop peu et survient de manière automatique en démocratie, est restée une chose rare voire introuvable chez nous, si elle n’est pas décrite comme un péché, un suicide social, ou une hérésie égoïste contre la famille, la tribu ou le clan.
Dans une contribution intitulée « Serigne Touba aurait-il soutenu une guerre entre musulmans ? » et datant du 20 mai 2015, notre compatriote Abdou Aziz Mbacke Majâlis nous proposait une nouvelle lecture de l’aventure belliqueuse du Pouvoir sénégalais en Arabie Saoudite. Cette décision de participer à la guerre du Yémen en cours aurait été prise sous le prétexte, entre autres, de défendre les lieux saints de l’Islam. Sans cabotiner davantage sur la nature véritable de cette guerre que l’on sait évidemment nationale, notre compatriote revenait sur l’inconsistance des arguments brandis par le belligérant sénégalais pour justifier son expédition dans la péninsule arabique. Le problème majeur consiste dans la campagne autoritaire du Pouvoir sénégalais en la mobilisation d’arguments essentiellement religieux adossés à une instrumentalisation peu savante et frauduleuse des productions intellectuelles et de la biographie des illustres guides religieux. Plus préoccupant dans cette affaire est le soutien mercenaire apporté à cette falsification mémorielle et théologique par quelques franges de la classe de ce qu’on appelle communément les « chefs religieux ».
Une pratique politique susceptible de libérer une société n’est sans doute pas celle dont cette société n’est ni l’inventeur, ni le véritable acteur, encore moins le bénéficiaire. Pour qu’il puisse en être ainsi, la pratique politique doit être liée à l’histoire et à la culture politique d’une société de deux manières au moins. Soit elle est un processus social qui inspire fondamentalement l’activité idéologique reflétant la culture ou le dynamisme culturel propre à cette société. Ou bien encore la pratique politique est le résultat des innovations idéologiques ou intellectuelles par lesquelles se constitue et se transforme une société, et donc s’écrit son histoire. La pratique politique est dans ce cas tributaire des formes du pouvoir politique et des modalités de l’action politique qui en sont déterminées. En effet, les formes du pouvoir affectent le potentiel d’innovation idéologique d’une société.
Le 26 avril 2014 nous consacrions une petite réflexion à la loi sur la déclaration de patrimoine votée le 21 mars 2014 par l’Assemblée Nationale du Sénégal. Dans ce texte que nous avions intitulé « Le grenier, les « mains sales » et la loi sur la déclaration de patrimoine », nous nous interrogions sur la portée et l’efficience de cette loi. Nous avions particulièrement remis en cause la restriction de la force de cette loi dont la conséquence était de laisser des opportunités ouvertes à la perpétuation des crimes économiques et financiers, cela en dépit des explications et des assurances fournies par le Ministre de la Bonne gouvernance de l’époque, lesquelles nous paraissaient insuffisamment fondées à plus d’un titre.
Jusqu’ici le gouvernement du Président Macky Sall faisait reposer sa politique de sécurité nationale sur le renforcement des moyens des forces de défense et de sécurité. L’insuffisance des effectifs et le vieillissement des corps de sécurité se mêlant à la montée de l’insécurité dans les quartiers semblent avoir justifié la mise en place des agents de sécurité de proximité, un corps dont la légitimité et l’opportunité étaient fortement controversées. Par ailleurs, l’efficacité technique et le calibrage éthique de ce corps, au demeurant difficile à qualifier – on ne sait pas s’il relève de forces civiles ou paramilitaires – est mise en doute par la réalité concrète de tous les jours.
Au Sénégal il semble s’être développé sur les flancs d’une gouvernance affairiste un certain réflexe voir un mouvement « petit-bourgeois ». L’on pourrait s’accroîtrait à prendre cette tendance pour une dynamique socioculturelle ordinaire, mais, contre les apparences, il pourrait s’agir peut-être de l’une des nombreuses indications que la société sénégalaise est en train de négocier, non sans difficultés, une transition sociale et politique sans précédent ; qui plus est dans un contexte où les mécanismes de la régulation et de la socialisation sont, les uns démantelés dans une entreprise consciente de gouvernance extravertie, les autres assimilés, bricolés et imposés à partir de répertoires et d’univers socioculturels sinon étrangers du moins qui s’emparent d’une grande partie de la classe moyenne : ces « nouveaux riches » produits, non pas par un homme, mais par le système-wadiste qui résiste encore au dirigisme de l’émergence ; c’est-à-dire l’effet conjugué d’une économie de la prédation et de ce qui s’apparente à un épicurisme existentiel primitif.
Il parait que l’horizon 2016 a été retenu pour l’introduction officielle de l’éducation sexuelle à l’école au Sénégal. Petit à petit, des femmes intellectuelles, moins brillantes et plus paresseuses qu’on ne le croit, ainsi que des magistrats avides de subsides et de prestige professionnel international s’organisent dans leurs sortes d’associations et d’ONGs occultes pour précipiter cette politique dont la logique est la substitution de l’école à la famille et au parent tout court. Il n’est pas un hasard si des institutions comme l’UNESCO, la Cour Internationale de Justice, le Tribunal Pénal International, les ONGs de droits de l’homme, et Fondations et Chancelleries étrangères regorgent d’experts en éducation, de magistrats et d’activistes sénégalais. Le but de cette politique d’éducation sexuelle présentée machinalement comme une générosité humanitaire est d’isoler l’enfant de toute forme d’autorité parentale, communautaire, religieuse et culturelle afin de le livrer incrédule à l’endoctrinement néolibérale afin d’en faire un être hypersexualisé dès le bas âge, un futur consommateur et un pilier de l’économie néocapitaliste qui se nourrit de l’industrie du sexe (gadgets et pratique sexuelles, médicaments relatifs) et des loisirs.
De plus en plus, on voit émerger au Sénégal une espèce de fratrie qui, pire qu’une sécularisation à marche forcée, est en train d’opérer une dé-spiritualisation insidieuse de la vie sociale. On ne peut l’appeler autrement qu’une fratrie, puisque, au fond, elle en donne bien l’air à travers ses méthodes, ses idées et ses réseaux, nouant ainsi entre hommes et femmes de petites solidarités horizontales au sein des institutions publiques chargés de la régulation des modes de pensés, des codes culturels comme la mode, les loisirs, et les métiers de l’art et de la communication, et surtout de l’ordre publique. Ce faisceau copernicien de liens sociaux est relié de manière verticale à des centres et sous-centres de commandement ayant leurs origines dans les grandes démocraties occidentales où les groupuscules ultralibéraux et naturistes ont presque achevé de mettre la main sur les quatre secteurs les plus importants du système social libéral : l’éducation, la santé, la communication (incluse sociale, soit la culture), le gouvernement (inclus justice, défense et sécurité, politique, économie).
La colonisation avait besoin de territoires, elle a bâti des colonies. Le néocolonialisme avait besoin d’agents, il a bâti ses colonisés. Ces derniers se chargent eux-mêmes de s’auto-coloniser et de coloniser leurs peuples à la place du colonisateur de naguère. La recolonisation a trouvé les deux : terres et peuplades. La liberté a perdu la case.
Au lieu de condamner les pays occidentaux pour avoir opportunément brandi leurs vaccins obtenus de dur labeur, en plus agissant, comme à l’accoutumée, dans le casting classique du mendiant et du pieu donateur, nous devrions plutôt réfléchir sur la responsabilité de nos gouvernements, de nos chercheurs et professionnels de la santé et de la sécurité. C’est un minimum à défaut de pouvoir faire violence sur notre fierté pour rendre grâce aux équipes d’interventions et aux gouvernements étrangers pour avoir sauvé des vies jusque-là. Le virus Ébola est toujours là et demain, un autre pourrait lui succéder. Et il n’y aura ni Père Noël, ni mère Theresa, ni Lady Diana pour nous faire don de vaccins et de soins primaires.
« Sache que les divergences entre les écoles doctrinales ou rites juridiques (madhahib) constituent dans la religion un immense bienfait et une grande vertu. Cette divergence renferme un secret subtil que perçoivent les savants et qui échappent aux ignorants ». Imam Jalalu d-Din Suyuti. Jazil al mawahib fi ikhtilafi al-madhahib (L’abondance des bienfaits dans les différences d’opinion entre les écoles juridiques)
Le Colonel Abdou Aziz Ndaw nous apprend dans son ouvrage qu’il avait préalablement observé le silence (« silent option ») des procédures pendant une longue période, en adressant ses requêtes à qui de droit. C’est ensuite, faute de recevoir les réponses attendues, que le Colonel s’est finalement résolu à la « voice option » pour parler comme Anthony Oberschall, à prendre la parole publiquement à travers un ouvrage. Cette prise de parole est pour certains une imprudence inutile ou un acte revanchard, et pour d’autres une violence illégale contre le bien suprême de l’Etat, sans jugement a posteriori. Quoi qu’il en soit, cette publication rentre dans le cadre de ce qu’on peut appeler un dévoilement, une dénonciation, visant à limiter ou à sanctionner des usages non encadrés du secret par le pouvoir politique ou l’Etat. L’intérêt de cette prise de parole n’est pas seulement d’informer le citoyen sur la manière dont en haut lieu on s’occupe de ses droits, de sa sécurité et du bien public, mais de montrer l’importance d’une science du secret en politique, d’un intérêt intellectuel et documenté pour l’usage du secret en politique.