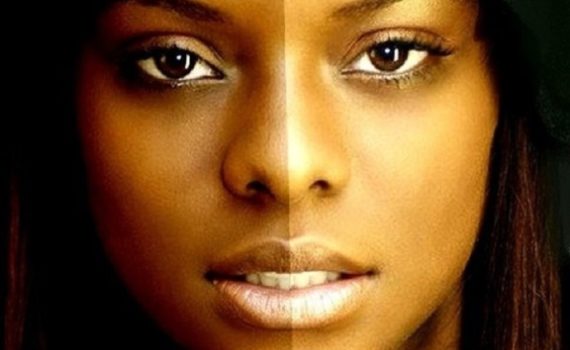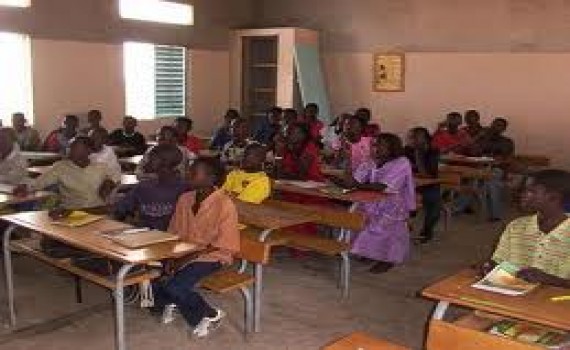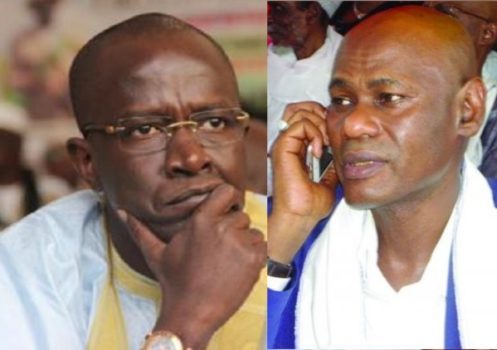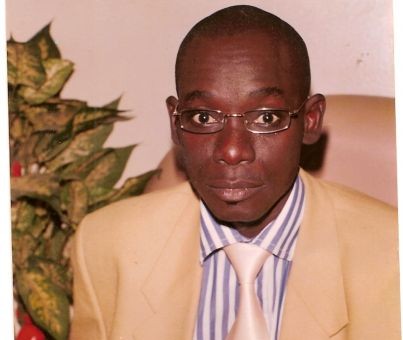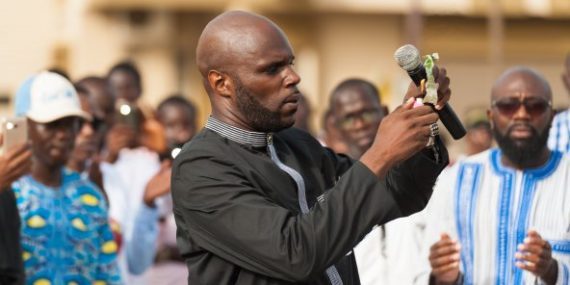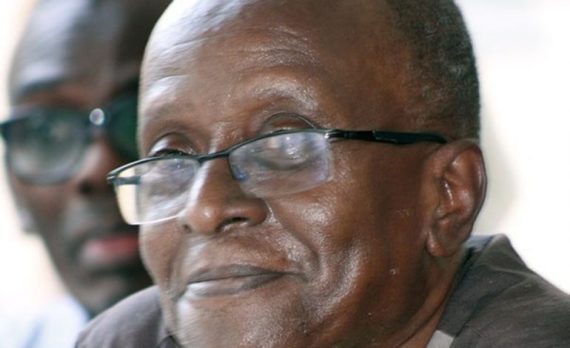Nos femmes, nos dames, nos sœurs et tantes croupissent sous le poids d’une course effrénée vers la bénédiction d’Aphrodite, cette déesse de la Beauté et de l’Amour dans la mythologie grecque. Tout pour la beauté, tout pour être beau. La beauté n’a jamais été autant divinisée qu’à notre époque. Ce culte de la beauté est […]
Contributions de Alassane K. KITANE
C’est vrai qu’en 2019 le peuple sera appelé à choisir un Président de la république, c’est vrai qu’il sera question pour notre nation de savoir s’il faut renvoyer l’actuel Président ou lui renouveler sa confiance. Mais au-delà d’une simple question de changement d’homme, il sera plutôt question d’une reconquête de la souveraineté populaire usurpée, mais aussi d’un sursaut éthique dans notre rapport à la chose publique en général à la politique en particulier.
Succédané d’une version fanatique du scientisme, la technocratie consacre l’avènement des ingénieurs, des savants et, plus généralement encore, des experts en tout genre au pouvoir. Squattant la légitimité populaire, la technocratie constitue aujourd’hui une résurrection d’une certaine aristocratie (gouvernement des élites) dans la démocratie. Les spécialistes des sciences humaines, les experts en communication et les intellectuels médiatiques en constituent la trame de fond. Nantis de connaissances scientifiques (au sens large du terme), ils vendent leurs services au plus offrant (c’est-à-dire au pouvoir) et n’hésitent pas à habiller leur prise de position par un discours scientifique ou pseudo scientifique dans le but d’imposer leur volonté politique.
Selon le dernier recensement, le Sénégal compte 127 130 fonctionnaires. C’est établi qu’au Sénégal, en plus de la culture millénaire de la famille élargie, tout fonctionnaire a sous sa tutelle deux à trois fils de parents ou d’amis. Parmi ces fonctionnaires, il y aurait à peu près 92 560 enseignants, dont 25452 femmes (une femme fonctionnaire a toujours sous sa tutelle d’autres enfants).
Le régime de Macky Sall qui, au lieu de gouverner le Sénégal, se contente de communiquer, n’en finit pas d’inonder les Sénégalais avec son arsenal de slogans et de formules de rhétorique. Le fameux slogan «la patrie avant le parti» est tombé en désuétude sans doute à cause d’une mal gouvernance de plus en plus banalisée. Après le lyrique «yonnu yokkuté», le délirant «gouvernance sobre et vertueuse» et la chanson «plan Sénégal émergent» devenue trop triviale à force d’être imposée à nos oreilles, il fallait sortir une formule qui puise tant bien que mal accrocher: «le Sénégal de tous et pour tous».
Le Sénégalais est-il un peuple qui se nourrit d’illusions et de fantasmes ? C’est la question qu’inspirent nos comportements dans tous les domaines de la vie sociale. Jamais sevrés d’illusion, les Sénégalais n’aiment pas qu’on les réveille de leur vie onirique. Ainsi dans la religion, dans la politique comme dans le travail, la réalité est abolie pour faire place à l’univers sans contrainte du rêve. Dans un pays où des gens peuvent se vanter d’avoir comme activité « toog mouy dox » (être riche sans jamais rien entreprendre), le travail est une servitude et le civisme une aberration. Dieu fait toujours bien les choses : car si la religion musulmane était née au Sénégal, le génie de notre roublardise l’aurait complétement vidée de sa substance humaniste pour en faire un instrument de damnation des hommes.
La grande énigme de la communication, c’est qu’elle cache plus qu’elle ne révèle, du moins à ceux qui ne savent comprendre les messages que par les mots. Au-delà des mots, le sens se cache derrière des suggestions, des gestes, des regards et des tics. C’est ce qui fait que les chefs d’État font tout pour maîtriser leur image aussi bien dans les instants de discours que dans leur langage corporel de tous les jours.
Qu’on ne m’oppose pas les actes d’indélicatesse de quelque brebis galeuses, je veux chanter un corps et une vocation. A toi enseignant, quel que soit le lieu où tu défends la nation contre les assauts de l’ignorance et de l’obscurantisme, je dirai avec Jalal Rum Adini « au-delà des valeurs du bien et du mal, […]
Qu’arrive-t-il lorsqu’un État est au bord de la faillite ? Quels sont les signes d’une économie en faillite ? A ces questions, les chroniqueurs en économie répondent toujours quasiment de la même façon : un État n’a pas de biens mobiliers ou des bijoux de valeurs à aliéner pour se refaire une santé financière ; […]
Les mois de novembre, décembre et janvier sont traditionnellement des moments d’épanouissement et d’espoir d’un renouveau dans la qualité de vie, dans le monde rural. Après trois mois de labeur et de débauche intense d’énergie, tout paysan rêve de récolter les fruits de son labeur. Mais dans notre pays, les prémices de belles récoltes sont souvent des symptômes de stress à cause d’une campagne agricole hasardeuse.
L’une des caractéristiques de la société de consommation est que les citoyens y sont très prompts à assimiler des idées et des schémas intellectuels, mais sont d’une extrême paresse lorsqu’il s’agit de produire des réflexions par eux-mêmes. Or l’imitation est certes un des facteurs essentiels de la socialisation de l’individu, mais aucune société viable ne […]
Alors que la question de l’opportunité de l’autoroute Ila Touba n’est pas encore vidée par une délibération citoyenne de plus en plus exigeante sur l’utilisation des deniers publics, Macky Sall persiste et s’aventure dans des décisions plus que hasardeuses. La ligne ferroviaire Dakar-Tivaouane est, dit-on, ressuscitée : depuis le 16 octobre 2017, 2 circulations entre […]
Qui a dit que l’esclavage a été aboli ? Nos forces vives ont été, pendant des siècles, transplantées dans un cynique commerce triangulaire et quand les négriers ont vu que c’en était trop, ils ont décidé que l’esclavage était un crime contre l’humanité. L’esclavage est donc contraire à la dignité humaine : mais l’est-il plus que la spirale infernale dans laquelle nous enchaine la dette ? Sinon, comment expliquer qu’entre 1982 et 1998, les pays du Sud aient remboursé quatre fois le montant de leurs dettes ? Comment expliquer cette arnaque qui consiste à déprécier le prix des matières premières au moment même où le service de la dette devient plusieurs fois plus important que la dette elle-même ?
Qui disait que le temps de l’Africain est cyclique ? Même s’il a tort de le dire, nous ne faisons rien pour lui montrer qu’il a tort. Nous sommes très souvent pris dans un tourbillon d’une histoire qui bégaye au lieu de progresser. Retour en arrière non seulement dans les actes, mais aussi dans l’interprétation de notre histoire. Nos hommes politiques nous promettent toujours la rupture et le progrès, mais à l’arrivée, ils se retournent honteusement, regardent dans le rétroviseur, pour nous servir le même refrain : « mes prédécesseurs aussi le faisaient ». Nous sommes donc d’éternels damnés de la politique et nous devons toujours refaire les mêmes fautes ; l’essentiel étant que les auteurs des fautes changent !
«Et l’on peut juger de la cervelle d’un seigneur rien qu’à voir les gens dont il s’entoure. Quand ils sont compétents et fidèles, on peut croire à sa sagesse, puisqu’il a su les reconnaître compétents et les maintenir fidèles ; mais s’ils sont le contraire, on peut douter de ce qu’il vaut lui-même, puisque la première erreur qu’il commet réside dans ce choix». Machiavel
Au-delà du cas Assane Diouf, quel est notre rapport à la violence ? La définition de la violence comme excès de force ou comme force brutale et extrême révèle déjà qu’on la déprécie d’une certaine façon. Pourtant dans l’éducation de nos enfants, dans l’art, dans le sport et dans la politique, la violence est omniprésente. Si ce n’est pas la violence physique c’est celle morale ou verbale qui est utilisée. Le statut de la violence dans notre société est donc problématique et ce, d’autant que les moyens de communication n’ont jamais été aussi démocratisés. La question est dès lors de savoir comment se fait-il que malgré les mass-médias et les réseaux sociaux, la violence est si répandue dans notre société ? Pourquoi tant de meurtres, de rixes et d’insultes ?
Dans un univers d’imposture généralisée et d’ignorance entretenue à dessein, faire preuve de lucidité est un acte de courage rare, mais aussi risqué. En brûlant le billet de banque, Kémi savait parfaitement qu’il était en train de détruire la propriété d’autrui, en l’occurrence, la Bceao qui est elle-même la propriété de la France. Mais que pouvait-il faire d’autre ? L’héroïsme s’inscrit toujours dans une dialectique entre la normalité et l’anormalité, entre le lyrisme et le réalisme, entre le symbolisme et la praxis résolue gage d’innovation.
C’est très affligeant de voir un esprit aussi raffiné s’enfoncer avec persistance dans l’erreur à cause d’une simple posture partisane. Alors qu’on s’attendait que Monsieur le conseiller culturel du Président fasse amende honorable sans équivoque et ferme définitivement cette parenthèse, on voit plutôt un homme qui continue de rejeter la faute sur les autres. La seule réponse qu’on attendait était de votre part est : « mea culpa ». C’est comme si Monsieur Dia disait en résumé « j’ai fait une erreur, mais je ne suis pas le seul. J’ai tort, mais j’ai également raison ». Cette posture est d’autant plus étonnante qu’elle est en contradiction flagrante aussi bien avec la culture philosophique dont le professeur est suffisamment imbu qu’avec son statut de conseiller culturel du Président.